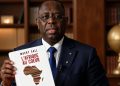Kenya, Rwanda, Afrique du Sud… Dans plusieurs pays africains, les fonds de pension se développent. Un secteur de la finance risqué ?
En mars 2021, le think tank américain Rocky Mountain Institute, spécialisé dans l’efficacité énergétique, saluait les fonds de pension africains pour leurs investissements dans les projets d’énergie propre. De quoi « déclencher une boucle de rétroaction positive sur la croissance économique », commentait alors Nicolette Pombo-van Zyl pour ESI Africa.
En février dernier, le plus grand fonds de pension au Kenya, KEPFIC, avec ses 4,4 milliards de dollars d’actifs, annonçait un futur partenariat dans le secteur des infrastructures avec des firmes chinoises. Des entreprises « qui ont déjà démontré leur capacité de mener de gros projets à terme », assurait le directeur du régulateur des pensions au Kenya, RBA.
Plus tard, toujours en février dernier, le directeur de Kigali International Finance Centre (KIFC), Ntoudi Mouyelo, annonçait l’ouverture d’un fonds pour l’investissement « dans la dette obligatoire des PME africaine ». Un projet dans lequel le Rwanda Social Security Board (RSSB) investira des dizaines de millions, en partenariat avec des fonds luxembourgeois et suédois.
Puis le 3 mai, Bloomeberg annonçait que le plus grand fonds de pension d’Afrique, le sud-africain GEPF, investirait 1,6 milliard de dollars dans des « sociétés non cotées ».
Tout un paradigme. Car la circulation de ces fonds passe par la bourse sud-africaine ou la Banque africaine de développement (BAD). Mais comme tous les investissements de capitaux, cet argent sera indubitablement sous le contrôle des gestionnaires de fonds. Ces derniers sont généralement les agences de développement européennes, les fonds de pension américains et les banques étrangères.
Quels risques pour les fonds de pension ?
A l’exception de l’inévitable possibilité que les fonds investis soient détournés dans d’autres projets que ceux promis aux fonds de pension africains, le risque d’une perte lourde est très élevé. Surtout pour les investisseurs minoritaires comme les fonds de pension africains.
Le journaliste et chercheur Alex Park, spécialiste en agriculture africaine, déplore que « ce qui est bon pour les investisseurs (occidentaux, ndlr), n’est pas bon pour les Africains ». Il prend comme exemple l’entrée des fonds de pension brésiliens, pendant la présidence de Luiz Inácio Lula da Silva, sur le marché financier. Une expérience réussie, dans un sens, mais qui avait surtout enrichi les actifs des entremetteurs en bourse à l’étranger, faisant chuter les actions du fonds de développement agricole de l’Etat brésilien, l’IFAD.
L’Ouganda avait connu le même retour de boomerang. En 2019, des milliers d’éleveurs et producteurs de produits laitiers – Pearl Dairy – avaient investi, avec le fonds américain Rise Fund, dans une opération de vente à crédit sur le marché financier. Mais en mars dernier, le groupe de médias ougandais Daily Monitor avait dénoncé que la société mère de Rise Fund, Texas Pacific Group (TPG), collaborait avec les concurrents de Pearl Diary. Le but était en réalité de faire baisser les prix du lait au point que la vente ne soit plus viable, que les agriculteurs s’appauvrissent jusqu’à vendre leurs parts dans l’opération.
Il faudrait aussi relever qu’en dépit des restrictions dans les pays africains concernés, les gestionnaires des fonds de pension préfèrent investir à l’étranger que dans les pays d’origine, ou en Afrique plus généralement.