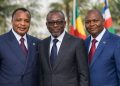Les « enfants de la rue » font partie de ces figures emblématiques de la misère et de la relégation familiale qui nourrissent les préjugés. Enquête ethnographique au Burkina Faso.
Les « enfants de la rue » sont à la croisée des fantasmes : le cas des « mineurs isolés » errant dans certaines rues de la capitale française le démontre bien. Ils suscitent souvent des impressions confuses, oscillant entre la compassion pour des êtres trop tôt meurtris et la crainte diffuse d’un déferlement de misérables.
Pourtant, rejoindre la rue ne prend pas les mêmes formes à Paris, à Pékin, à Calcutta, à Ouagadougou ou à Kinshasa. Chaque environnement urbain est caractérisé par ses impasses et par ses opportunités spécifiques. Mes enquêtes de terrain, menées à leurs côtés à Ouagadougou depuis plus de dix ans, m’ont conduite à envisager les « enfants de la rue » autrement que par l’opposition entre victime et menace.
Seuls dans la rue ?
Au Burkina Faso, un habitant sur deux a moins de 16 ans. La sociabilité en milieu urbain se déployant très largement dans l’espace public, les « enfants de la rue » ne se distinguent guère, au quotidien, de la masse des enfants et des jeunes qui parcourent les rues de la ville : petits commerçants ambulants, élèves coraniques mendiants, enfants jouant au football dans les rues de leur quartier ou jeunes assis à l’ombre d’un arbre en train de refaire le monde autour d’un thé.
Ils ne sont pas non plus les seuls enfants à dormir dans la rue. Ces derniers sont sous la responsabilité d’un adulte (un parent, un maître coranique, l’aveugle qu’ils assistent, la commerçante pour laquelle ils travaillent, etc.).
Les « enfants de la rue », quant à eux, y vivent de manière autonome. C’est donc moins le lieu qu’une position relationnelle qui les caractérise.
Ils mangent globalement à leur faim, ce qui n’est pas le cas de tous les Burkinabè. La mendicité, les petits boulots, les vols et les trafics sont des sources de revenus non négligeables. Malgré l’omniprésence de la violence et une carence affective évidente, les loisirs et les amusements composent une part importante de leur quotidien. Ceux qui vivent du vol portent parfois des vêtements « dernier cri », voire envoient occasionnellement de l’argent à leurs parents restés au village. De fait, ils sont rarement orphelins, et ce d’autant moins dans une société où les frères et les sœurs des géniteurs de l’enfant sont considérés par lui comme des pères et des mères.
Nombre de ces « enfants » de la rue y grandissent et ont une vingtaine d’années, voire plus. Les « enfants de la rue » peuvent donc être des « adultes ». Leur présence, qui signale implicitement les limites des projets de réinsertion, est cependant largement occultée. Les associations caritatives ne viennent en aide qu’aux individus mineurs : à l’âge de 18 ans, l’enfant de la rue, victime à aider, devient brutalement un délinquant impénitent à enfermer.
Les « enfants de la rue » sont donc très loin d’être les seuls enfants dans la rue et, surtout, ne sont pas tous des enfants. Ils jugent en outre que cette appellation est calomnieuse et stigmatisante : elle sous-entendrait qu’ils sont nés « dans la rue », voire « de la rue » – au sens où ils seraient des « fils de la rue ». À la limite, ils préfèrent l’appellation bakoroman, un terme issu du langage nouchi, l’argot urbain de Côte d’Ivoire, qui désigne celui qui vit et dort dans la rue, sans que personne n’y soit responsable de son existence.
Migrer dans la rue ?
Si la misère se rencontre à tout âge, il est apparu que seuls des adolescents adoptent ce mode de vie, le plus souvent entre 12 et 17 ans. Les bakoroman les plus âgés sont simplement restés dans la rue. Mais passé 25 ans, ils se font rares. L’observation de leurs trajectoires redessine ainsi les contours de l’adolescence, d’ailleurs confirmés par les travaux récents en neurobiologie, qui ont démontré que le cerveau n’atteint sa pleine maturité qu’autour de l’âge de 25 ans, même si la loi considère désormais qu’on est adulte dès l’âge de 18 ans.
Les bakoroman ont le plus souvent cherché à échapper à des situations familiales difficiles (pauvreté, divorce, abandon, décès, etc.). Ils aiment pourtant se présenter comme des migrants, acteurs de leur destin.
Pour les jeunes Burkinabè, la migration est un « départ en aventure » et un moyen reconnu d’accéder à des ressources matérielles, d’élever son statut social et de gagner en expérience en se frottant au vaste monde, avant de s’installer dans sa vie d’adulte. Quitter son foyer peut être porteur d’espoir quand ni la famille ni l’État ne vous proposent un chemin vers la réussite : bon nombre d’enfants travaillent aux champs toute la journée, les classes rassemblent parfois plus de 100 élèves et les frais de scolarisation empêchent trop souvent de poursuivre l’école au-delà du cycle primaire.
Les bakoroman cherchent ainsi à s’inscrire dans une certaine normalité du départ en aventure des adolescents et des jeunes hommes en Afrique de l’ouest. Et tout comme pour les migrants qui remontent le Sahara ou qui embarquent sur des bateaux de fortune pour traverser la Méditerranée, réduire leur mobilité à un dernier recours face à la misère empêche de comprendre leurs trajectoires.
La position toujours plus précaire des mineurs et des travailleurs non qualifiés sur le marché du travail, l’insécurité grandissante dans le monde rural et la structuration de réseaux de bakoroman qui prennent en charge l’accueil des nouveaux arrivants contribuent à canaliser certains jeunes aventuriers vers les mirages de la rue. Ils s’agrègent ainsi, toujours plus nombreux, à des réseaux marginaux, marqués par une consommation massive de drogue, une hiérarchie souple, une faible tolérance à la contrainte et l’accès à des gains d’argent relativement importants. Autant de caractéristiques qui compliquent leur réinsertion, d’autant plus que, dans la rue, ils ont raté cette étape essentielle pour la suite qui est celle de la formation, scolaire ou en apprentissage.
Au bout de la rue ?
Replacer la rue dans le prisme des migrations juvéniles permet de comprendre le taux d’échec important des projets de réinsertion institutionnels, qui considèrent les bakoroman comme relevant de l’enfance en danger. Ces programmes proposent généralement un retour en famille assorti d’un modeste soutien matériel ou économique, ou un placement en centre d’hébergement, en vue d’une scolarisation ou d’une entrée en apprentissage. Non seulement ces initiatives n’apparaissent pas toujours comme des solutions aux yeux des enfants pris en charge mais de plus, elles nient leur projet d’indépendance économique et leur désir d’affirmation individuelle.


Cette aide n’en reste pas moins indispensable. Parce que ce mode de vie est conditionné par les opportunités offertes par l’indétermination de leur statut, entre l’enfance et l’âge adulte, les bakoroman savent que la rue prendra fin en grandissant. Tandis que certains s’enlisent, entre toxicomanie, clochardisation et criminalité, d’autres parviennent à tourner définitivement le dos à la rue et à devenir des chefs de famille responsables. Si la rue ne constitue jamais le raccourci vers la réussite que certains espéraient, elle ne représente pas pour autant une voie sans retour.
Le mode de vie adopté par la majorité des « enfants de la rue » est conditionné par l’entre-deux, ni enfants – ils sont capables de survivre seuls – ni adultes – ils n’ont pas encore acquis de responsabilités. Ce n’est qu’en leur reconnaissant pleinement leur capacité d’action, mais sans oublier qu’ils n’ont pas encore la maturité et les compétences nécessaires pour se prendre en charge, que nous pourrons les accompagner à sortir des impasses de la rue.
L’ouvrage de Muriel Champy, « Faire sa jeunesse dans les rues de Ouagadougou », vient de paraitre aux éditions de la Société d’Ethnologie.
Muriel Champy, Maîtresse de conférence en anthropologie, Aix-Marseille Université (AMU)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.



















![[Série] Les tyrans d’Afrique : al-Sissi, le pire dictateur de l’Egypte moderne ?](https://afriquechronique.com/wp-content/uploads/2021/08/marechal-sissi-120x86.jpg)