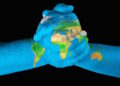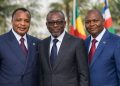Tout au long du XIXe siècle et jusqu’aux années 1920, la France a été l’un des principaux pôles d’attraction des étudiants étrangers grâce à la libéralité de son accueil. Les mesures d’ouverture, telles que la création de collèges, lycées et instituts culturels à l’étranger, de bourses, puis l’introduction d’équivalences, cours de français et certificats adaptés ont façonné une politique sans égale en Europe, au service du prestige et de l’influence diplomatique de la France. C’est ainsi que, entre 1880 et 1930, le nombre d’étudiants étrangers connaît une croissance plus élevée en France qu’ailleurs (Allemagne, Suisse, Autriche-Hongrie, Belgique, Italie, Royaume-Uni), passant de 5,6 % de la population étudiante totale en 1890 à 15 % en 1910.
Aujourd’hui, d’après les chiffres du ministère de l’Enseignement supérieur, la France demeure une destination attractive auprès des étudiants en mobilité internationale. En 2019-2020, le pays a accueilli 365 000 étudiants étrangers, soit presque 13 % de la population totale inscrite dans les établissements français (2,7 millions). Ce flux est en hausse, porté par les écoles d’ingénieur et de commerce.
Toutefois, en dix ans, les mobilités étudiantes ont augmenté de 68 % sur le plan mondial et de seulement 32 % en France. La France connaîtrait donc une perte relative de son attractivité. Le nombre d’étudiants étrangers qu’elle recrute augmente moins rapidement que la moyenne mondiale, et leur part dans la population étudiante française totale diminue légèrement (-1 % entre 2014 et 2019). Passée de la troisième à la sixième place dans le classement des pays d’accueil, la France se fait doubler par des pays non anglophones, comme l’Allemagne et la Russie.
Si au cours de la dernière décennie le nombre global d’étudiants en mobilité internationale s’est considérablement accru (en moyenne de 5,5 % par an), cette augmentation a surtout concerné la Chine, la Russie et autres pays hors zone OCDE, c’est-à-dire les pays du Sud. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Allemagne, la France et le Canada demeurent les principaux pays d’accueil en nombre absolu, mais la croissance est plus rapide dans des pays non membres de l’OCDE où le nombre a augmenté de 7 % par an en moyenne, contre 4,9 % dans les pays de l’OCDE. Les étudiants étrangers inscrits dans des pays hors OCDE représentent aujourd’hui environ 31 % de la population mondiale d’étudiants en mobilité, contre 23 % en 1998.
Une organisation des universités peu lisible à l’international
Dans un rapport de 2021, la Cour de Comptes dresse un portait en demi-teinte de l’université française. Tout en saluant les efforts qui ont permis à cette dernière de se positionner en haut des classements internationaux, elle constate l’échec des réformes qui se succèdent, depuis la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) de 2007, en termes de lisibilité internationale.
En rappelant les injonctions consécutives, parfois contradictoires, qui – à un « rythme effréné » – ont conduit les établissements français à se regrouper, à fusionner, à signer des contrats d’association et à élaborer des politiques de site, la Cour s’interroge.
La question de la marque est cruciale pour la lisibilité à l’échelle internationale. Paradoxalement, à force de vouloir promouvoir l’excellence et la visibilité de l’enseignement supérieur en faisant levier sur son fort ancrage territorial, les politiques publiques semblent faire l’impasse sur l’ancienneté et le prestige de la marque des établissements dans la construction des réputations mondiales.
Les universités qui occupent les premières places dans les grands classements mondiaux valorisent toutes, sans exception, une marque ancienne, inchangée depuis leur fondation. Harvard, MIT, Princeton, Yale, Cambridge, London School of Economics, Tsinghua, l’université de Tokyo : aucune de ces universités n’envisagerait de troquer sa marque historique contre un acronyme nouvellement créé ou une dénomination géographique générique de territoire.
L’insuffisante notoriété internationale de l’enseignement supérieur français est, selon la Cour des Comptes, la conséquence d’une autonomie inachevée. Contrairement aux ambitions initiales, les réformes n’ont pas permis aux universités, largement dépendantes des subventions pour charge de service public, de se doter de l’autonomie de gestion et des moyens nécessaires pour affronter la compétition internationale qui se joue sur les infrastructures, les conditions d’accueil et la vie étudiante, ainsi que sur les bourses et les perspectives d’emploi à la sortie des études.
Sans oublier, plus récemment, l’engagement en matière de développement durable et de responsabilité sociétale de l’établissement, domaine dans lequel l’enseignement supérieur français semble prendre du retard par rapport aux voisins européens, et qui compte de façon croissante parmi les critères de choix des candidats internationaux.
La France attire de moins en moins les étudiants de lycées français et d’Afrique
Si la France peine à suivre l’accélération de la concurrence internationale sur les nouveaux viviers, constitués essentiellement d’étudiants anglophones en provenance d’Asie (Chine, Inde, Vietnam), elle semble également perdre du terrain sur ses réseaux d’influence traditionnels : les bacheliers des lycées français à l’étranger, tout comme les candidats venant des pays d’Afrique francophone commencent à délaisser la France pour se tourner vers de nouvelles destinations.
Depuis plus d’un siècle, le réseau d’enseignement français à l’étranger est l’un des outils les plus puissants de la diplomatie d’influence de la France. Confié depuis 1990 à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), ce réseau, d’une densité unique au monde, s’appuie aujourd’hui sur 522 établissements dans 139 pays accueillant 370 000 élèves, dont environ plus de 60 % ne sont pas des ressortissants français.
Ces lycéens étrangers, francophones et formés aux programmes de l’enseignement secondaire français, ont été historiquement nombreux à opter pour la France. Portant, selon une enquête Campus France réalisée en 2018, la part de bacheliers étrangers des lycées français à l’étranger qui choisissent de faire leurs études supérieures en France est en baisse de 2 % depuis 2015, alors que le nombre d’établissements augmente.
« Boudent-ils l’Hexagone », comme le titrait Le Monde dans un article de juin 2019 ? De fait, ils étaient 46,2 % en 2018 à se tourner vers la France, contre 47,7 % en 2014. Ils sont en revanche plus nombreux qu’autrefois à choisir le Canada, les États-Unis ou le Royaume-Uni (+25,6 % entre 2013 et 2017). Parmi l’ensemble des bacheliers AEFE ayant choisi la France, 56,2 % viennent d’un lycée du continent africain, mais ce public est, lui aussi, en diminution.
Un étudiant étranger sur deux en France est originaire d’un pays d’Afrique. La France reste ainsi le premier pays de destination des étudiants africains en mobilité, devant les États-Unis, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Parmi les 10 premiers pays d’origine des étudiants étrangers en France, 6 sont africains : Maroc (1), Algérie (2), Sénégal (4), Tunisie (5), Côte d’Ivoire (7), Cameroun (10). Toutefois, la part des étudiants africains en France est en recul depuis quinze ans, au profit de pays tels que l’Arabie saoudite, le Canada francophone, l’Allemagne, l’Italie, l’Ukraine, la Malaisie, l’Indonésie et les Émirats arabes unis, jugés plus attractifs.
Pour des raisons démographiques, géopolitiques et climatiques, la part de l’Afrique dans la mobilité étudiante mondiale continuera à augmenter fortement dans les années à venir. La France saura-t-elle se positionner ?
Par la création d’universités franco-étrangères en Afrique, elle souhaite accompagner le développement de l’enseignement supérieur sur place. Toutefois, la stratégie « Bienvenue en France » de 2018, qui recentre l’attractivité étudiante sur l’excellence et sur la diversification des pays d’origine, assortie d’une différenciation des frais de scolarité pour les candidats hors Union européenne, est perçue dans cette région comme l’expression d’une politique de l’immigration choisie, posant ainsi un défi de taille à la capacité à maintenir l’attrait de l’université française.
Par ailleurs, la France est historiquement une terre de formation des dirigeants mondiaux (chefs d’État, chefs de gouvernements…). Mais, en miroir des baisses constatées pour le public général, la France est aussi en perte de vitesse dans la formation des élites mondiales, contrairement au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui progressent.
Une recherche française en perte de vitesse
L’image de l’université française serait également mise à mal par un marché des personnels de recherche insuffisamment compétitif à l’échelle internationale. La part des étrangers parmi les enseignants-chercheurs titulaires recrutés reste modeste, se situant à 10-15 % selon les postes.
Contrairement aux pays anglosaxons et asiatiques, la France se caractérise en effet par une fort taux d’endorecrutement, à savoir le recrutement des enseignants-chercheurs par l’établissement dans lequel ils ont effectué leur doctorat ou ils ont été maître de conférences, créant ainsi un frein à la venue d’enseignants étrangers qui s’ajoute à la faible attractivité des rémunérations et des perspectives d’évolution, surtout dans le secteur public.
Quant aux jeunes chercheurs, la France reste parmi les 10 pays les plus attractifs du monde pour les doctorants étrangers mais, contrairement aux autres pays de l’OCDE, cet effectif ne fait que baisser depuis 2013 (-9 %), alors que l’Allemagne, pour la même période, réalise une augmentation de +57 % et que la Suisse compte plus de doctorants étrangers que de nationaux (56 %).
La capacité à attirer les talents scientifiques n’est pas anodine car elle conditionne fortement les performances nationales en matière d’innovation. L’agence de presse américaine Bloomberg, qui établit tous les ans le Global Innovation Index, un classement des pays selon leurs capacités d’innovation, analyse ainsi le déclin relatif des États-Unis, classés premier pays du monde en 2013, et qui ont disparu du top 10 en 2021. Même si les universités américaines sont mondialement connues, les restrictions dues à la politique migratoire des dernières années vis-à-vis des étudiants et chercheurs pourraient être à l’origine de cette contre-performance.
Les pays qui se situent invariablement en tête de cet index – Corée du Sud, Singapour, Suisse et Allemagne – se distinguent par des politiques volontaristes en matière d’accueil de scientifiques étrangers et par des universités compétitives à l’échelle mondiale. La France est absente de ce palmarès alors qu’elle l’un des pays à fort coefficient de recherche.
Si les chercheurs français continuent de figurer régulièrement parmi les lauréats du prix Nobel, nombre d’entre eux ont effectué la majeure partie de leur carrière scientifique à l’étranger, comme d’autres nombreuses professions intellectuelles ayant émigré ces dernières années. Le dernier rapport de l’Observatoire des Sciences et Techniques publié par le Hcéres en 2021 confirme que la place de la recherche française baisse lentement mais constamment, tant en nombre de publications qu’en indice d’impact. En 15 ans, la France est passée du 6e au 9e rang des premiers pays publiants et ses publications sont de moins en moins citées.
De nouveaux entrants progressent rapidement dans de nombreuses disciplines et, contrairement à la France, se spécialisent dans les domaines à plus forte publication mondiale ou les plus dynamiques. Le faible niveau de financement public et privé de la recherche française (2,22 % en 2016, au-dessous de la moyenne OCDE) contraste avec les stratégies de puissance scientifique de nombreux pays émergents, tels la Chine ou Singapour.
Une attractivité académique plombée par les politiques migratoires ?
Dans un contexte de concurrence internationale accrue et de redéfinition des équilibres, l’enseignement supérieur français dispose d’atouts liés à son histoire mais se heurte à la difficile convergence entre les multiples objectifs que les politiques publiques lui imposent tour à tour : diplomatie d’influence, innovation technologique au service du développement économique, augmentation de ressources économiques propres, internationalisation…
C’est sans doute en matière de politique migratoire que les difficultés de coordination avec la politique d’attractivité universitaire sont les plus manifestes. Alors que la France souhaite accroître ses capacités d’innovation et de recherche, la rétention de ses jeunes diplômés étrangers reste un enjeu. Selon une étude du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq) près de 40 % des diplômés étrangers rentrent chez eux après l’obtention de leur diplôme.
La transition études-emploi s’avère souvent difficile et l’octroi d’un titre de séjour à l’issue des études, notamment des très qualifiés, reste soumis à des critères de salaire minimum ou d’adéquation entre emploi et niveau de qualification. Plus étonnant encore, la France figure parmi les pays qui intègrent le moins de migrants à son marché du travail sans réussir à transformer ce potentiel en une source d’innovation et de croissance pour son économie. Leur insertion professionnelle est d’autant plus difficile et lente que la part des migrants faiblement qualifiés est plus élevée en France que chez ses voisins européens.
Pourtant, c’est précisément entre le milieu du XIXe siècle et la Belle époque, lorsque la France se distinguait en Europe par sa politique d’accueil libérale réservé aux étudiants étrangers venus de tous les continents, y compris les victimes de persécutions religieuses et de discriminations politiques, que le rayonnement de ses universités a été le plus éclatant et son influence intellectuelle hors de ses frontières la plus déterminante…
Alessia Lefébure, Sociologue, membre de l’UMR Arènes (CNRS, EHESP), École des hautes études en santé publique (EHESP)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.