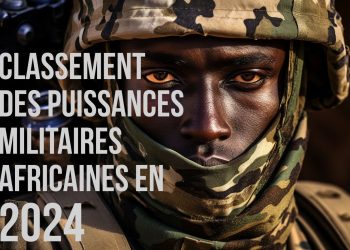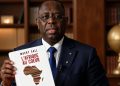Si les populations du Nord-Kivu ont résisté aux mesures prises pour contrer l’épidémie d’Ebola, c’est parce que, à leurs yeux, les autres fléaux auxquels elles sont confrontées ne sont guère traités.
Les réponses politiques aux pandémies telles que le Covid-19 et Ebola ont déclenché de nombreuses formes de résistance dans le monde entier. Cette résistance a souvent été tournée contre les mesures de confinement et autres restrictions imposées à la liberté de mouvement des personnes. Mais, dans le cas de la pandémie d’Ebola dans l’Est de la République démocratique du Congo (2018-2020), l’urgence sanitaire a donné naissance à une défiance populaire contre l’action humanitaire au sens large.
Les habitants de la province du Nord-Kivu, particulièrement touchée, ne semblaient pas seulement sceptiques quant à l’existence de la nouvelle épidémie, malgré son impact dévastateur (le bilan officiel fait état de 2 287 décès). Certains d’entre eux sont allés jusqu’à s’attaquer à des Centres de Traitement d’Ebola (CTE), aux agents de santé et aux soignants (selon le ministère congolais de la Santé, il y a eu 132 attaques contre les équipes de la riposte, qui se sont soldées par 4 morts et 38 blessés parmi les membres des équipes sanitaires et les patients), ce qui a sérieusement perturbé la réponse de l’État à l’épidémie et restreint l’accès aux communautés touchées.
Cette réaction violente doit être analysée en tenant compte des nombreux problèmes structurels et cycliques que la région subit depuis plusieurs décennies. Elle a exprimé une hostilité à plusieurs niveaux à l’encontre des donateurs internationaux, des humanitaires et des autorités congolaises, jugées incapables d’assurer la sécurité et d’instaurer une paix durable dans les zones touchées par un conflit prolongé. Depuis l’année 2014, la ville de Beni, au Nord-Kivu, est le théâtre de plusieurs exactions. Les personnes meurent sans savoir pourquoi elles sont tuées. Très souvent ces crimes ne sont pas revendiqués mais portent la signature du groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF selon le sigle anglais).
Les diverses causes de la résistance aux mesures anti-Ebola
Les attaques visant les CTE, les agents de santé et les humanitaires apportant leur aide ont été conduites par divers acteurs, notamment des groupes armés, des chefs coutumiers, des patients et leurs familles.
Si une grande partie de la population est restée méfiante face à la riposte à Ebola, une infime partie des habitants voulaient d’une part que les centres soient protégés pour que leurs proches continuent de recevoir les soins appropriés et, d’autre part, pour ceux qui y étaient engagés, conserver leur travail.
Les différentes attaques se fondaient sur des croyances selon lesquelles la maladie aurait été inventée par des acteurs extérieurs pour : a) exterminer la population ; b) tester les nouveaux vaccins des multinationales ; ou c) capter les financements des bailleurs de fonds au profit des organisations internationales, des ONG et du gouvernement central de Kinshasa.
Mais il convient de souligner que, au-delà de ce discours sur les origines et les objectifs de la réponse, les populations locales ont profité de l’attention portée à la pandémie pour demander une amélioration de leurs conditions de vie globales. La crise sanitaire provoquée par le virus Ebola a été utilisée comme un espace de protestation et d’expression de la frustration face à la définition des priorités dans le cadre des réponses humanitaires.
Les explications de cette résistance s’appuient généralement sur deux points de vue différents. Le premier est ce que nous appelons une interprétation culturaliste, qui considère la résistance aux réponses à Ebola comme une manifestation d’une vision du monde « arriérée » véhiculée par des populations elles aussi « arriérées ». Cette vision du monde devrait être renversée par des campagnes de sensibilisation, afin de se conformer aux réponses humanitaires rationnelles du type top-down.
L’autre point de vue est une perspective socio-anthropologique qui soutient que les réponses à Ebola doivent s’adapter aux réalités locales afin d’être efficaces et durables. Les deux points de vue reflètent la conviction que la résistance aux réponses à Ebola cache quelque chose d’irrationnel, d’exotique, de particulièrement africain et d’apolitique, que la première perspective veut voir effacer et la seconde intégrer aux politiques existantes.
Mais il y a plus. La résistance à la riposte au virus Ebola dans l’Est de la RD Congo n’est pas seulement devenue une expression de refus « face aux schémas impersonnels et déshumanisants des interventions sanitaires ». C’était aussi un moyen d’exprimer des revendications politiques et de demander, plus largement, l’amélioration des conditions de vie existantes. Les habitants du Nord-Kivu ont dénoncé la façon dont leur corps était traité dans les centres de santé (selon qu’on est une personne internée ou suspectée, le soin s’est apparenté à un enfermement) pour revendiquer leur droit à une vie et une existence décentes.
Des populations qui expriment un besoin de reconnaissance
La résistance de la population locale à ces mesures peut être considérée comme une forme d’activisme politique exprimant la contestation d’un humanitarisme local et international sélectif et inefficace.
L’insuffisance ou même l’incapacité de la stratégie de réponse à reconnaître et à s’adapter au contexte local (voir par exemple le manque de connaissance des langues locales, l’exclusion des membres de la famille lors des funérailles des victimes d’Ebola ou l’ignorance des rituels de mort, l’hyper-sécurisation et la militarisation des interventions de réponse, les conflits d’intérêts face à une équipe composée principalement d’étrangers, etc.) n’ont fait que renforcer la volonté de résistance.
Les appels populaires ne s’adressaient pas seulement aux interventions sanitaires en tant que telles mais exprimaient également des revendications politiques plus profondes. Les habitants du Nord-Kivu ont compris que la maladie à virus Ebola mobilisait les institutions internationales bien plus que les phénomènes qui les tuaient à une échelle bien plus large, tels que les conflits armés, le paludisme et toutes ces épidémies liées aux problèmes d’hygiène et d’assainissement – autant de questions que l’État congolais a depuis longtemps cessé de traiter.
Cette résistance populaire contre la riposte à Ebola pendant l’épidémie (2018-2020) au Nord-Kivu a montré comment de tels actes ne peuvent être détachés de leur sens plus large et de leur contexte local. Déclarer Ebola comme une catastrophe sanitaire, c’était, sans le dire explicitement, révéler les liens entre le virus Ebola et la politique. En effet, cela a mis en évidence la façon dont toutes les autres catastrophes, qui constituaient déjà la toile de fond de la vie de la population locale depuis plusieurs années, ont été ignorées par les autorités congolaises et par la communauté internationale.
Les soins et la prévention préconisés dans le cadre de la lutte contre Ebola visaient à sauver des vies, mais ces efforts contrastaient fortement avec le manque de protection offert par ailleurs à des habitants habitués à côtoyer des atrocités au quotidien et pour qui rester en vie relevait souvent du miracle. Pour toutes les personnes vivant dans la zone touchée, l’imprévisibilité d’Ebola n’a pas constitué une rupture, une discontinuité dans leur mode de vie habituel. Pour elles, les conditions matérielles et de sécurité comptent autant que les conditions biologiques de la vie. Cela nous enseigne que s’il est de bon ton de se préoccuper d’une vie menacée dès que possible, cela devrait être le cas pour toutes les vies en danger, quelle qu’en soit la cause.
Il ressort de tout ceci que les théories complotistes (extermination de la population, détournement des fonds, tester les vaccins, etc.) ont été à la base de plusieurs actions de résistance. Le bilan humain de 4 morts est à déplorer. S’appuyant sur l’une ou l’autre théorie, les personnes impliquées dans les actes de résistance nous livrent toutefois un message – à savoir que si nous voulons sauver des vies, nous devons prêter une attention particulière à tout ce qui les met en danger. Qu’il s’agisse d’un virus ou des nombreuses autres menaces auxquelles ces populations font face au quotidien.![]()
![]()
Aymar Nyenyezi Bisoka, professeur assistant, Université de Mons; Koen Vlassenroot, professeur de sciences politiques et sociales, Ghent University et Ramazani K. Lucien, doctorant en sciences politiques et sociales, Université catholique de Louvain
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.