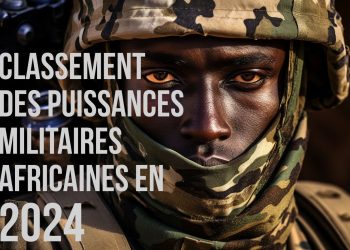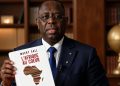Dans les territoires d’arrière-pays méditerranéens, des communautés gèrent collectivement les ressources naturelles et les paysages.
Au même titre que l’huile d’olive ou la diète méditerranéenne, le pastoralisme est emblématique des territoires d’arrière-pays de la Méditerranée ; ici, la rapidité du changement climatique est supérieure aux tendances mondiales.
Depuis 2011, des paysages culturels de l’agropastoralisme méditerranéen, comme le Causse Méjean en France, ont été inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Depuis des siècles, voire des millénaires, des communautés d’éleveurs méditerranéens gèrent des communs pastoraux de montagne.
Les « communs », un geste politique collectif
Ces formes collectives d’appropriation ont occupé par le passé et encore aujourd’hui une place importante : de nombreuses communautés humaines les ont utilisées pour gérer durablement l’accès à des ressources renouvelables aussi diverses que des systèmes d’irrigation, des stocks de poissons, des forêts, des pâturages et des territoires de parcours, la flore ou la faune sauvages…
Pour l’économiste Gaël Giraud, ces « communs » désignent :
« les ressources, symboliques ou matérielles, qu’une communauté choisit d’administrer en se dotant de règles qui sont elles-mêmes soumises à délibération. Ce qui définit le commun n’est donc pas la nature de la ressource, mais le geste politique d’un collectif qui soumet à un discernement communautaire continue ses propres manières de faire dans la protection et la promotion de ce à quoi il tient. »
Ainsi, il n’existe pas de « communs » par essence et les institutions que nous construisons sont déterminantes pour leur défense.
Les trois principes au cœur des communs pastoraux
Les communs pastoraux peuvent s’analyser grâce au cadre théorique de la résilience des systèmes socioécologiques.
Les communs pastoraux des montagnes méditerranéennes relèvent aussi de la catégorie des « aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire » (APAC), aussi appelés « territoires de vie ».
De nombreuses organisations internationales – UICN, CDB, UNEP ou UNDP par exemple – les considèrent comme autant d’espaces clés de conservation des écosystèmes et des paysages. Ces territoires et les systèmes de gestion collective des ressources qu’ils soutiennent se caractérisent par trois principes fondamentaux, interconnectés, qui ne sont pas sans rappeler certains des « design principles » élaborés par Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 2009 pour ses travaux sur les « communs ».
Ces trois principes peuvent s’énoncer ainsi : une communauté locale entretient des liens forts et profonds avec un territoire ; cette communauté est un acteur majeur dans les processus de prise de décision en lien avec la gouvernance territoriale des ressources ; cette gouvernance contribue à une gestion responsable et durable des écosystèmes et du patrimoine matériel et immatériel de ces mêmes communautés.
Déclin, résistance ou renouveau des « territoires de vie »
Ces « territoires de vie » de la Méditerranée sont plus que jamais confrontés à des défis majeurs dans un contexte de mondialisation des échanges, de changement global et de fortes transformations socio-économiques, politiques, démographiques et culturelles.
La biodiversité terrestre de ces espaces fait désormais face à de multiples perturbations.
Dans les pays de la rive nord de la Méditerranée, l’urbanisation, notamment côtière, a supprimé ou fragmenté de nombreux écosystèmes. En raison du déclin de l’agriculture et des systèmes agropastoraux, la surface boisée augmente aux dépens de ces deux secteurs.
Les écosystèmes semi-naturels des pays des rives sud et est sont de leur côté menacés de fragmentation ou de disparition en raison de l’urbanisation, du défrichement, de la surexploitation du bois (de chauffage, d’œuvre) et du surpâturage.
Le tout, sous la pression du changement climatique, de la démographie, de la pollution des milieux terrestres et aquatiques, mais aussi de l’air, sans oublier les tensions géopolitiques régionales persistantes (Maroc/Algérie, Libye, Israël/Palestine, Syrie…)
Autant de défis plus ou moins bien appréhendés au sein des APAC, pouvant conduire à des formes de déclin, de résistance ou de renouveau des communs selon les situations. Ces divers aspects feront l’objet, ce lundi 6 septembre 2021, d’une session thématique dans le cadre du congrès mondial de la nature qui se tient à Marseille.
L’agdal pastoral au Maroc, un cas d’école
Au Maroc, l’agdal constitue une pratique de gestion communautaire, reposant sur la protection de ressources spécifiques au sein d’un territoire délimité. Cette gestion sociospatiale est en général respectée par tous les acteurs des communautés locales, menacés de sanctions dans le cas contraire. L’agdal est donc un territoire important pour la cohésion des communautés, en particulier pastorales.
L’agdal constitue un mode gestion en bien commun emblématique de la montagne amazighe (berbère) au Maroc et dans le nord de l’Afrique. L’agdal s’entend le plus souvent comme un « pâturage commun soumis à des mises en défens saisonnières », qui correspond à l’agdal pastoral, la forme la mieux documentée et la plus importante en matière de superficie.
Au cours de la longue histoire des sociétés pastorales du Maghreb et du Sahara, la nécessité de protéger les pâturages à certaines périodes de l’année a probablement joué un rôle de premier plan dans la genèse de l’institution.
Chaque agdal dispose de ses propres règles d’ouverture et de fermeture. Les dates sont déterminées par deux critères principaux : tout d’abord, les conditions climatiques et l’altitude – plus l’agdal est haut, plus les dates d’ouverture pour le parcours sont tardives ; ensuite, la disponibilité d’autres ressources et espaces pastoraux.
Les villageois organisent la transhumance et la montée vers les alpages en fonction des ressources dont ils disposent aux abords des villages et dans les forêts voisines. Ils retardent l’accès aux agdals pour l’été. La transhumance estivale et l’accès aux agdals d’altitude revêtent aujourd’hui encore une importance stratégique pour les communautés agropastorales de l’Atlas.
Des pratiques anciennes adaptées au contexte actuel
Longtemps considéré comme une relique du passé, l’agdal trouve une résonance nouvelle avec le succès du développement durable et la nécessité de réinventer des formes, adaptées au contexte actuel, de gestion concertée des ressources indispensables au maintien de l’identité et à la survie des populations de ces zones dites « marginales ».
Les pratiques véhiculées par l’agdal sont proches des notions de base en écologie concernant l’importance de la gestion différentielle selon un zonage précis. Les communautés de pasteurs, en cherchant par exemple à préserver les graminées tardives, protègent toute la biodiversité contenue dans les différents faciès des écosystèmes. Les espèces de graminées peuvent ainsi être considérées comme des espèces parasols. C’est un des principes clés de la biologie de la conservation.
Mais les pratiques d’agdal sont aujourd’hui confrontées à la transformation rapide des systèmes de production et d’activité, à l’ouverture de la petite paysannerie sur le marché prônée par les politiques publiques, à l’individualisation des comportements entraînant l’affaiblissement des régulations communautaires, à l’intervention publique instaurant de nouvelles formes institutionnelles de sécurisation et de gestion.
Des études de terrain montrent néanmoins la résilience et la capacité de résistance de ces formes locales de gestion, la grande souplesse et l’adaptabilité de ces pratiques.
Il s’agit désormais d’inventer les agdals de demain, dans une perspective de « conservation participative », intégrant aux processus de prise de décision l’ensemble des acteurs concernés et reposant sur un concept local qui fait encore sens pour la population. Mais pour combien de temps encore ?
Cristelle Duos (IRD) a contribué à l’élaboration de cet article.
Bruno Romagny, Directeur de recherche en économie des ressources renouvelables, Institut de recherche pour le développement (IRD); Mohamed Alifriqui, Professor of Ecology and Plant biodiversity, Université Cadi Ayyad et Pablo Dominguez, Chargé de Recherche au CNRS en éco-anthropologie, Université Toulouse – Jean Jaurès
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.