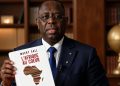En 2023 et 2024, le Mali et le Burkina Faso ont adopté de nouveaux codes miniers visant à accroître la participation nationale dans l’exploitation de leurs ressources aurifères. Ces réformes marquent un tournant vers un nationalisme des ressources, une approche qui cherche à maximiser les retombées économiques locales des industries extractives.
Une volonté de souveraineté économique
Le Mali, troisième producteur d’or en Afrique, a promulgué en août 2023 un nouveau code minier (Loi n° 2023-040) qui permet à l’État de détenir une participation gratuite de 10 % dans les projets miniers, avec la possibilité d’acquérir jusqu’à 30 % supplémentaires dans les deux premières années de production commerciale. De plus, une part de 5 % peut être cédée à des investisseurs locaux, portant ainsi la participation nationale potentielle à 35 %.
Au Burkina Faso, la révision du code minier en juillet 2024 a renforcé la participation de l’État, passant de 10 % à 15 %, avec la possibilité pour l’État ou le secteur privé national de souscrire à au moins 30 % du capital des entreprises minières.
Des résultats contrastés
Au Mali, en 2023, le secteur minier a injecté 644 milliards de francs CFA (environ 1 milliard de dollars) dans le budget de l’État, représentant 21,5 % des finances publiques. La production industrielle d’or a atteint 70 tonnes, générant des recettes d’exportation de 500 milliards de francs CFA (784 millions de dollars).
Cependant, en 2024, la production industrielle d’or a chuté de 23 %, passant à 51 tonnes. Cette baisse est attribuée à des conflits entre le gouvernement et des compagnies minières internationales, ainsi qu’à des incitations réduites pour les nouveaux investissements en raison des nouvelles réglementations.
Au Burkina Faso, la mise en place de la Société de Participation Minière du Burkina (SOPAMIB) a permis à l’État de prendre le contrôle de deux mines industrielles, Boungou et Wahgnion, précédemment exploitées par Endeavour Mining. En 2024, les entités étatiques ont collecté plus de 8 tonnes d’or, et plus de 11 tonnes au premier trimestre 2025.
Une nouvelle approche économique
Ces réformes s’inscrivent dans une volonté de rompre avec les modèles économiques hérités de la période coloniale, où les ressources naturelles étaient principalement exploitées par des entreprises étrangères avec une faible redistribution des bénéfices au niveau local. Le nationalisme des ressources vise à renforcer la souveraineté économique, à développer les capacités locales et à assurer une meilleure répartition des richesses.
Au Burkina Faso, cette stratégie est également motivée par la nécessité de revitaliser une économie affaiblie par l’insécurité et de répondre aux besoins d’une population confrontée à des défis socio-économiques majeurs.
Défis et perspectives
Malgré les intentions louables, ces réformes présentent des défis. Au Mali, l’augmentation des taxes et la participation obligatoire de l’État ont suscité des inquiétudes parmi les investisseurs étrangers, certains envisageant de se retirer du pays.
Au Burkina Faso, bien que les résultats initiaux soient prometteurs, la pérennité de cette approche dépendra de la capacité du gouvernement à gérer efficacement les mines nationalisées et à maintenir un environnement attractif pour les investissements.
Le Mali et le Burkina Faso illustrent une tendance croissante en Afrique vers un contrôle accru des ressources naturelles par les États. Si cette approche peut potentiellement renforcer la souveraineté économique et favoriser un développement plus équitable, elle nécessite une mise en œuvre prudente pour éviter de décourager les investissements et de compromettre la croissance du secteur minier.