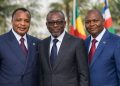Le pionnier du reggae soul Muzavazi Musaka, alias Jah Love, est mort le 16 février dernier à l’âge de 31 ans. Presque un mois plus tard, les hommages continuent d’affluer du monde entier.
Le musicien Sou Jah Love, diagnostiqué malade du diabète dès l’âge de 7 ans, a succombé des suites de sa maladie chronique. L’artiste du Zimdancehall, un genre musical qu’il a lui-même créé et popularisé, a fait revivre l’idiome jamaïcain dans la musique zimbabwéenne. Il a été un artiste original, qui a chanté la douleur et la résilience des ghettos de l’Afrique australe.
En partant du reggae grill, un style venu tout droit de Jamaïque, qui s’était transformé en rap à son arrivée aux Etats-Unis, Sou Jah Love y a intégré le beat afro afin de créer des rythmes entraînants, ponctués de paroles poétiques venues des ghettos. Le succès commercial a rapidement été au rendez-vous.
Surtout, Jah Love savait parler à son public. Ses rimes, l’artiste les chantait en shona, la langue bantoue du Botswana, de la Zambie et du Mozambique. Mais pas question pour lui de s’enfermer dans un carcan : sa musique était, comme il le disait de son vivant, « une musique à mille pères ».
Soul Jah Love a puisé ses paroles dans un ancien répertoire de vers et d’expressions de l’Afrique entière. Hakurotwe Mude, Sekuru Gora, Bob Marley, Fily Sissoko ou encore Gwendolyn Brooks ont toujours été ses références poétiques, qu’il se réappropriait ensuite sans limites.
Soul Jah Love était aussi un musicien engagé, connu pour son féminisme. Voilà qui détonnait dans le paysage de la trap music. « Les filles du village ont des fissures aux pieds si larges qu’elles engloutissent tout le sable sur le chemin », chantait-il. L’artiste partait généralement de références féministes pour s’attaquer aux injustices sociales.
L’âme du Zimbabwe
La star du Zimdancehall, bien que l’un des artistes les plus prolifiques et les plus doués des dix dernières années, n’a jamais eu le respect des symphonistes du mhondoro, le monde des chanteurs supra-territoriaux de l’afro, dont la musique traverse le monde. Plus que quiconque, Soul Jah Love a fait plus que chanter en shona, il a réinventé ce dialecte, dont il a vulgarisé les expressions, qui font maintenant partie de l’argot zimbabwéen. Les pamamonya (« sans-abri ») ou les chingunduru (« petites gens ») sont désormais deux expressions fréquemment utilisées pour décrire les démunis au Zimbabwe.
La vie de l’artiste est aussi une success story sociale : issu du ghetto Mbare de Harare, Soul Jah Love vient d’une génération qui connait encore la ségrégation raciale du néocolonialisme britannique. Le quartier a vu aussi son lot de tragédies lors du siècle passé, et ses habitants ont grandi face à la mort et au sang, en plus de la pauvreté extrême.
C’est autour de ces ghettos que le mythe de Soul Jah Love s’est développé. Même s’il a lui-même passé son enfance dans le quartier de Waterfalls, il a vécu son adolescence à Mbare, orphelin. Et le ghetto a été sa mère et sa muse, sa musique était universelle car la réalité des quartiers pauvres est la même partout, en Afrique, mais aussi dans les pays occidentaux.
C’est pour cela que dans sa chanson la plus importante, « Pamamonya ipapo », il se définit comme un chien affamé qui arrache l’os aux canines d’un molosse. Plus tard, sa musique a traduit les tumultes de son âme troublée. Moins déterminé, à cause de la maladie et de l’abus d’alcool, Soul Jah Love a tout de même proposé des titres mémorables, comme « Ndichafa Rinhi » — comprenez « Quand vais-je mourir ? —, dans lequel il avait prédit son propre décès.
Ironie du sort : le gouvernement zimbabwéen a organisé à Soul Jah Love, qui pointait du doigt les inégalités sociales dans son pays, des funérailles d’Etat. Un héros est mort. Mais sa musique a survécu, de nombreux jeunes musiciens la portent et c’est grâce à Soul Jah Love que la souffrance et la résistance ont trouvé des porte-paroles qui se sont frayé chemin dans l’industrie de la musique internationale. Une musique que même les puissants ne peuvent ignorer.