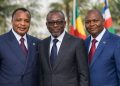Avec la fin annoncée de l’opération Barkhane au Mali, le Niger apparaît désormais comme un relais essentiel de l’action de la France au Sahel, écrit Marc-Antoine Pérouse de Montclos, directeur de recherches à l’Institut de recherche pour le développement (IRD).
Sur le plan militaire et géographique, d’abord, le pays se trouve en plein dans l’œil du cyclone, au centre de la coalition antiterroriste du G5 – le « Groupe des Cinq », qui combat des groupes affiliés à Al-Qaïda ou à l’organisation État islamique avec des troupes venues, outre du Niger, de Mauritanie, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad.
Sur le plan politique, qui plus est, il s’en sort mieux que ses voisins. Entouré du Mali et du Tchad, où les militaires ont repris le pouvoir en 2020 et 2021, le Niger a réussi à consolider ses acquis démocratiques. Au terme de deux mandats, le président sortant, Mahamadou Issoufou, a en effet accepté de céder la place à son dauphin, Mohamed Bazoum. Depuis l’indépendance en 1960 de cette ancienne colonie française, les alternances de gouvernement avaient plus communément pris la forme du coup d’État. C’est la première fois dans l’histoire du Niger que l’on a assisté à une succession entre deux présidents élus après la victoire de Mohamed Bazoum au second tour des élections.
Les dossiers brûlants du nouveau président
Aujourd’hui, les défis n’en sont pas moins immenses. Au nord, le Niger est menacé par les troubles de la Libye voisine ; à l’ouest, sur la frontière malienne, par les nébuleuses d’AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) et de l’EIGS (État islamique au Grand Sahara) ; au sud-est, en direction du Nigeria et du lac Tchad, par les djihadistes de Boko Haram.
Peu après la victoire de Mohamed Bazoum, et peu avant son investiture début avril 2021, le pays a par ailleurs connu une tentative de putsch menée par un capitaine de l’armée de l’air, Sani Gourouza, qui a depuis lors été appréhendé par la police au Bénin. À l’époque, beaucoup d’observateurs se sont perdus en conjectures sur la nature d’un coup d’État qui était mal préparé et qui aurait tout aussi bien pu être soutenu par l’opposition que par le camp du président sortant, les uns pour protester contre le résultat des élections, les autres pour, prétendument, justifier la proclamation d’un état d’urgence et une éventuelle prolongation du mandat d’Issoufou.
Quoiqu’il en soit des rumeurs sur une affaire qui est restée assez mystérieuse, l’événement a surtout signalé la fragilité d’un pays qui n’échappe pas aux maux de ses voisins. Le 21 mars dernier, par exemple, de nouveaux massacres ont entraîné la mort d’au moins 137 civils dans la région de Tahoua (ouest du Niger).
Lors d’un entretien avec l’auteur de ces lignes à Niamey juste avant son investiture le 2 avril, le président Mohamed Bazoum expliquait ainsi que, sur le plan sécuritaire, sa principale préoccupation était désormais cette zone dite « des trois frontières » (entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso) où sévissent « des bandits qui enlèvent du bétail, tuent des gens et imposent le paiement de leur dîme religieuse, la zakat ».
« Notre devoir, poursuivait-il, c’est de protéger l’intégrité physique des citoyens et de leurs biens. Nous ne voulons plus que de jeunes bergers en moto aillent dans les villages extorquer de l’argent et menacer nos concitoyens dans les régions de Tilabéri et Tahoua à la frontière du Mali. Boko Haram, c’est moins prioritaire. Au Niger, ce sont juste des bandits qui rançonnent la population. Ils sont dans des stratégies de survie économique et non de conquête territoriale pour établir un califat et y administrer des musulmans. À mon avis, le Boko Haram du Niger est très différent de celui du Nigeria. »
L’option de la négociation avec les djihadistes
Comme ses voisins sahéliens, le Niger fait cependant partie des pays les plus pauvres du monde et il n’a pas forcément les moyens de patrouiller efficacement des zones rurales et périphériques. Comme en Afghanistan ou au Mali, l’option des négociations avec les groupes djihadistes est donc à l’ordre du jour. La stratégie du président Bazoum consiste surtout à proposer une sorte d’amnistie aux combattants de Boko Haram qui acceptent d’être démobilisés et de rejoindre des centres de dé-radicalisation, d’une part, et à essayer de satisfaire les revendications communautaires des Peuls de l’EIGS, d’autre part.
Il nous l’a confié ouvertement :
« Quand je suis arrivé au ministère de l’Intérieur en mai 2016, j’ai vite compris qu’au Niger, les combattants de l’EIGS étaient surtout de jeunes Peuls de Banibangou, dans le département de Ouallam. Beaucoup venaient d’une ancienne milice d’éleveurs qui avait autrefois agi dans la zone et dont j’ai utilisé le chef pour servir d’intermédiaire avec Abou Walid al-Sahraoui [le chef de l’EIGS]. Je leur ai dit que j’étais prêt à négocier sur la base de revendications communautaires. L’accès à la terre, l’absence d’infrastructures sanitaires et scolaires, tout ça on pouvait l’entendre et j’étais même prêt à intégrer certains d’entre eux dans la garde nationale. Mais ils m’ont dit qu’ils étaient là pour faire le djihad au Mali et que le Niger ne les intéressait en aucune façon. Ils ont exigé que je libère leurs combattants, en échange de quoi ils s’engageraient à protéger la section de la frontière sous leur contrôle. J’ai alors étudié la liste des prisonniers en nos mains. »
Cet examen a donné lieu à des décisions variées selon la gravité des faits imputés aux personnes emprisonnées :
« Certains n’avaient pas de dossiers d’accusation et ont aussitôt été libérés. D’autres pouvaient être traduits en justice et paraissaient susceptibles d’être acquittés. Mais il y en avait quatre qui avaient commis des crimes de sang. Deux, notamment, avaient mené l’attaque contre la prison de Banibangou au cours de laquelle deux gardes nationaux avaient été tués. Ceux-là ne pouvaient pas se soustraire à un jugement. On aurait éventuellement pu envisager de les gracier après un procès mais il nous fallait des garanties, un accord. L’EIGS a refusé et nous a lancé un ultimatum. Ils ont alors attaqué la caserne de Banibangou fin février 2017 en enlevant un garde national qu’ils ont ensuite accepté de libérer en gage de bonne volonté. Mais les discussions n’ont pas avancé et la situation sécuritaire n’a cessé de se dégrader depuis lors, pendant qu’ils se renforçaient au Mali. »
Le nouveau président se veut donc prêt au dialogue mais estime que la partie adverse, elle, ne l’est pas :
« Qui pourrait être notre interlocuteur ? Nous n’en avons pas. Abou Walid al-Sahraoui ne peut pas être notre interlocuteur : ce n’est pas un Nigérien, je ne discuterai jamais avec lui. Il nous faut maintenant inverser le rapport de force militaire pour initier une discussion avec les éléments peuls du groupe : des jeunes Nigériens qui sont dans le djihad par égarement. Mais ça n’a pas de sens de discuter avec Abou Walid al-Sahraoui : lui-même ne le veut pas, il n’est pas nigérien. Son idée du djihad est complètement étrangère aux réalités locales ; il veut créer un autre État dans lequel le Niger n’existerait pas. »
Une situation plus stable qu’au Mali
Face à de tels défis, plusieurs éléments prêtent cependant à l’optimisme. Le Niger dispose en effet de certains atouts. Contrairement au Mali, d’abord, il a su intégrer les communautés touarègues dans la gouvernance du pays. Lui-même originaire d’un groupe arabe issu du Fezzan libyen, le président Mohamed Bazoum va sûrement poursuivre cette politique. Aux dernières élections, il a d’ailleurs fait le plein de voix en pays touarègue à Agadès et dans le nord.
Des raisons d’ordre structurel expliquent aussi la relative stabilité du Niger. Alors que Niamey est très excentré, Agadès fait figure de capitale symbolique du pays en dépit de sa situation au nord. De plus, la ville est moins isolée que Kidal, le fief des séparatistes touarègues au Mali. La région est plus intégrée à l’économie nationale, contrairement aussi à Diffa dans le sud-est, qui commerce surtout avec le Nigeria. Agadès a également bénéficié du boom de l’uranium dans les années 1970 et 1980. Aujourd’hui, les cours sont bas et des mines sont en train de fermer. Mais le boom aurifère amortit un peu ce choc économique.
Très jacobins, les militaires qui exerçaient le pouvoir à Niamey avant le retour à un régime parlementaire en 2011 avaient par ailleurs pris soin d’étendre le réseau routier du pays afin de ne pas laisser de régions isolées. La route dite de « l’unité » a par exemple été construite en 1973 sur plus de 500 km de distance entre Zinder, Diffa et Nguigmi. La différence est flagrante avec le Mali où, aujourd’hui encore, il n’y a toujours pas de voie bitumée entre Gao et Tombouctou ou Kidal.
Le contraste est tout aussi saisissant quand on compare l’évolution politique des deux pays. Dans les années 1990, le Mali était présenté comme un modèle de transition démocratique. Le Niger, lui, était toujours en proie à des coups d’État. C’est un peu l’inverse à présent. Au Mali, les militaires ont repris le pouvoir, d’abord en 2012, puis en 2020 et 2021. Le Niger, en revanche, connaît pour la première fois, nous l’avons dit, une alternance pacifique entre deux présidents élus.
Des élections contestées pour une transition réussie
Mohamed Bazoum explique notamment cette transition réussie par les différences entre son PNDS (Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme) et l’ADEMA (Alliance pour la démocratie au Mali), la formation arrivée au pouvoir après la chute de la dictature de Moussa Traoré à Bamako en 1991 :
« Quand nous étions dans l’opposition, nous avons tissé un vrai réseau au niveau national. Le parti est resté homogène et cohérent, un pilier de l’État, avec une vision forte du pays. Cela m’a permis de gagner les élections en dépit du caractère minoritaire de la communauté à laquelle j’appartiens. D’une année à l’autre, le PNDS rassemble à peu près 40 % des voix aux législatives, ce n’est pas non plus un parti hégémonique. Il a donc besoin d’alliances pour gouverner, ce qui a un effet sur la gestion du pays. »
Il ajoute, à propos de l’élection présidentielle qu’il vient de remporter, qu’il ne regrette pas de ne pas avoir été élu dès le premier tour :
« C’est la preuve que nous sommes dans un régime d’élections libres et transparentes. Tout en étant le candidat du parti au pouvoir, avec près de la moitié des sièges au Parlement, je n’ai pu réunir que 39,3 % des suffrages au premier tour. J’ai ensuite bénéficié du ralliement des candidats les plus importants : le troisième, qui avait 9 % des voix, et le quatrième, qui en avait 7 %. Avec le report de quelques autres partis, le bloc qui me soutenait réunissait à peu près 67 % des votes du premier tour. Mais je me suis retrouvé avec 55,6 % des voix au second tour, preuve qu’il s’agissait bien d’élections libres. »
L’opposition a néanmoins crié à la fraude, dénonçant notamment des taux de participation très élevés dans la région de Tahoua. Le président Mohamed Bazoum s’en explique ainsi :
« Nous avons d’abord eu des élections municipales et régionales le 18 décembre, puis des législatives et le premier tour des présidentielles le 27 décembre. À l’époque, personne n’a crié à la fraude. Pourtant, ce sont à peu près les mêmes résultats et les mêmes taux de participation qu’on a retrouvés dans chaque circonscription au second tour. On peut s’amuser à faire des comparaisons et on verra que je n’ai bénéficié, au mieux, que du transfert de voix auquel on pouvait s’attendre à l’issue des ralliements du premier tour.
De plus, mes meilleurs scores ont été réalisés dans des régions [du nord], Agadès et Taouha, où l’opposition n’avait tout simplement aucun représentant. Les seuls partis qui y avaient présenté des candidats m’ont soutenu au second tour. L’opposition, elle, a une implantation très régionale [dans le sud]. Elle n’avait pas de raisons de crier à la fraude au second tour plutôt qu’au premier. C’est d’autant plus évident que j’ai été moins performant au second tour, alors que j’aurais dû bénéficier à plein du report des voix du bloc qui me soutenait. Mais l’opposition voulait contester de toute manière, cela faisait partie de sa stratégie pour créer les conditions d’une situation de chaos. »
Une pratique démocratique qui reste à consolider
Il est vrai que le débat n’a pas toujours volé très haut. Des opposants ont remis en cause la nationalité nigérienne du candidat du PNDS et insisté sur son appartenance à une tribu minoritaire et originaire du Fezzan libyen, les Oulad Souleymane. Bazoum s’en plaint amèrement :
« Je suis le seul à m’en être tenu à mon programme et à ne pas avoir mené d’attaques personnelles. J’ai fait une campagne électorale qui a duré cinq mois et j’ai visité les chefs-lieux de 214 des 266 communes du Niger. J’y ai parlé de mon programme en matière d’éducation, d’infrastructures routières, d’électrification rurale, d’agriculture, d’élevage, de télécommunications, etc. Mes adversaires, eux, n’ont rien trouvé de mieux à faire que de s’en prendre à mes origines, au teint clair de ma peau. Et ils ont réussi à mobiliser une partie de l’électorat sur la base d’un discours haineux. C’est ça qui explique ma contre-performance du second tour. »
Un développement qu’il avait en partie anticipé, affirme-t-il :
« J’avais déjà signalé ce problème lorsque le président Issoufou voulait me convaincre de me présenter. Je lui ai dit que je n’étais pas forcément le meilleur candidat pour le parti car l’opposition risquait de mobiliser l’opinion publique sur la base du thème de mes origines et de ma couleur de peau. Mais le président Issoufou a estimé que j’étais le candidat le plus consensuel. Le parti avait déjà près de 50 % des sièges et le rapport de force était donc en notre faveur. Cette campagne sur le thème de mes origines a vraiment été choquante pour moi. Cela fait longtemps que je suis engagé en politique. J’ai assumé des responsabilités ministérielles et occupé plusieurs postes importants. Mais jusqu’à présent, je n’avais jamais été confronté à ce genre d’arguments douteux. Heureusement, cela n’a pas eu beaucoup d’effet ; certains qui mettaient en cause mes origines se sont finalement ralliés à moi, et nous avons tout oublié. Avec les autres aussi je veux passer l’éponge. »
À défaut d’ouvrir son gouvernement à des membres de l’opposition, Bazoum a alors redistribué des portefeuilles ministériels en fonction de ses soutiens au PNDS et des ralliements opérés entre les deux tours. Ces compromis ont visé à consolider et à élargir sa base sociale. Mais ils posent maintenant des questions sur la capacité du nouveau président à s’affranchir des logiques clientélistes pour lutter contre la corruption.
Trafics de stupéfiants, détournements des fonds destinés à acheter des armes, prévarication de certains fonctionnaires, violations des droits de l’homme par les militaires : les affaires ne manquent pas. À n’en pas douter, le bilan du président Bazoum se jugera aussi à l’aune de ses efforts en vue d’assainir les pratiques politiques du pays, et pas seulement de sa capacité à combattre les groupes djihadistes.![]()
![]()
Marc-Antoine Pérouse de Montclos, directeur de recherches, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.