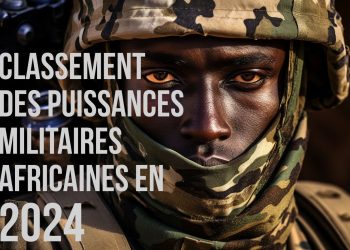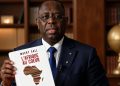La société kenyane est profondément multireligieuse. Au sein de ses communautés chrétiennes, les affiliations religieuses sont fluides… sauf en ce qui concerne l’athéisme, écrivant les chercheurs Yvan Droz et Yonatan N. Gez.
Au Kenya, la religion est omniprésente : le sondage Afrobarometer indique que 88 % des Kenyans considèrent que la religion est très importante dans leur vie. Selon le recensement de 2019, les 47,6 millions d’habitants sont à 85,5 % chrétiens et à 11 % musulmans. Au sein de la majorité chrétienne, les croyants sont répartis entre une multitude d’Églises (ou dénominations). Des communautés catholiques, anglicanes, presbytériennes et évangéliques (avec, parmi ces dernières, des Églises pentecôtistes particulièrement vivaces) vivent les unes à côté des autres.
Loin d’êtres étanches les unes aux autres, ces communautés religieuses se retrouvent sur un certain nombre de valeurs. Les responsables religieux chrétiens comme musulmans invitent ainsi leurs ouailles à se méfier des « quatre S », soit les scandales, les sectes, le satanisme et le sécularisme, expliquant que ceux qui y succombent s’éloignent de la grâce divine.
Par ailleurs, alors que le fondamentalisme islamique est perçu comme une menace bien réelle contre le christianisme kenyan – les Églises chrétiennes sont des cibles de choix du mouvement Al-Shabaab, affilié à Daech – l’islam est perçu par les chrétiens – à l’exception des pentecôtistes – comme un territoire religieux légitime, bien qu’étranger et éloigné.
Des identités religieuses fluides et plurielles
Lorsque l’on s’intéresse aux communautés chrétiennes, on s’aperçoit qu’une véritable fluidité des identités religieuses existe au Kenya. Loin d’être figée, l’appartenance à une dénomination est susceptible d’évoluer au cours du parcours de vie des individus, et n’empêche pas de s’investir dans des pratiques religieuses hors de sa communauté.
Les Kenyans peuvent ainsi adopter une dénomination qu’ils considèrent comme le cœur de leur affiliation, alors qu’ils maintiennent des liens plus « périphériques » avec d’autres formes religieuses. Ces liens s’incarnent dans des « allers-retours », ou des « visites » aux services religieux d’autres Églises, qui représentent une forme de participation « secondaire » et souvent exploratoire. Elle est généralement institutionnalisée et suit un protocole établi : présentation du visiteur lors du service religieux, accueil chaleureux, inscription sur un registre, etc.
Les Kenyans participent volontiers à différents services religieux au cours de la même semaine ou accompagnent des connaissances pour « visiter » d’autres cérémonies religieuses. Les convertis qui reviennent sur leur lieu d’origine, à la campagne, reprennent souvent leurs anciennes pratiques religieuses et participent aux services de leur confession précédente, sans que cela pose de problème.
Toutefois, ces visites peuvent devenir du « church hopping », littéralement, un « sautillement entre les Églises », une expression que l’on pourrait également traduire par « écumer les Églises », comme l’on écume les bars. Cette locution souligne le manque de stabilité religieuse d’une personne, qui ne parvient pas à maintenir une affiliation primaire solide. Un individu peut ainsi être soupçonné de changer d’affiliation pour créer des dissensions au sein des Églises, ou chercher à assouvir des intérêts vénaux, voire d’être un suppôt de Satan ou un athée.
Un marché religieux concurrentiel et spectacularisé
Derrière ces formes innovantes de mise en concurrence des offres religieuses, se cache parfois un certain scepticisme devant les abus commis par les responsables religieux. Ainsi, une journaliste présente l’histoire de Christine Ndegwa à Nairobi : « Une chrétienne qui préfère regarder les services religieux à la télévision plutôt qu’à l’église ». Ndegwa explique son choix en mentionnant son mécontentement envers les pasteurs actuels qui mèneraient une vie immorale, alors que leurs fidèles vivraient dans la pauvreté.
Ce suivi des offices depuis chez soi est possible grâce aux nombreuses chaînes religieuses existantes au Kenya. Les stations internationales sont également disponibles. On a ainsi accès à travers sa télévision à différents programmes télévisuels chrétiens, ainsi qu’aux « croisades » virtuelles des télévangélistes : ceux qui se livrent à cette pratique ne font donc pas du « church hopping », mais plutôt du « church zapping ».
Si le « church zapping » peut provenir d’une déception face aux prédicateurs actuels, il peut également être un moyen de faire face aux exigences des emplois salariés : les serveurs ou les réceptionnistes qui travaillent le dimanche peuvent « participer » aux services religieux ; de même que les chauffeurs professionnels qui écoutent ces émissions de radio au volant de leur taxi.
Du côté du personnel religieux, cette spectacularisation s’observe également. Afin d’éviter de voir leurs fidèles sombrer dans les péchés que proposent les divertissements populaires (alcool, sexe, disco, cinéma, etc.), les Églises chrétiennes proposent des services religieux où la musique et les arts de la scène n’ont rien à envier aux shows des professionnels du spectacle. Ces services hauts en couleur constituent une forme de loisir pour les fidèles… qui n’abandonnent pourtant pas tous les attractions plus séculières que peut leur offrir la vie nocturne des villes kenyanes.
Souligner l’enchevêtrement du séculier et du religieux permet de montrer que ce dernier n’est pas seulement un lieu d’engagement spirituel, mais également un espace de socialisation, de loisir et de plaisir. Nos interlocuteurs ont souligné le fait que les services religieux du dimanche sont souvent très « entraînants », qu’ils y prennent du plaisir et que « des choses s’y passent ». En outre, pour les très nombreux Kenyans qui disposent de ressources financières limitées, les loisirs qu’offrent les villes restent inaccessibles et les services religieux sont alors considérés comme un moyen de « passer le temps ».
À l’origine du « church hopping », la révolution religieuse des années 1980
La vague de conversions au pentecôtisme charismatique touche le Kenya depuis les années 80, comme nombre d’autres pays des Suds. Ce phénomène majeur a coïncidé avec le processus de libéralisation sociopolitique, simplifiant les procédures d’enregistrement des nouvelles dénominations religieuses et donnant un accès relativement libre aux différents médias. Les nouvelles Églises ont bénéficié d’une plus grande liberté de mouvement et d’une exemption des impôts : à la clef, une séparation entre l’Église et l’État réaffirmée, et l’apparition d’un puissant lobby religieux.
Les nouveaux missionnaires pentecôtistes ont profondément transformé le christianisme au Kenya. Ils proposent une liturgie charismatique, soulignent l’importance d’être « born again », c’est-à-dire « nés à nouveau ». Cette nouvelle naissance passe par un second baptême par immersion, caractéristique de la foi pentecôtiste. Souvent, le nouveau converti n’abandonne pas son affiliation religieuse précédente en devenant « born again », mais il ajoute une nouvelle facette à son identité plurielle (ethnique, religieuse, politique, socioéconomique, etc.) en se positionnant dans de nouveaux réseaux sociaux.
Au même moment surgirent des préoccupations quant aux déviances et aux manipulations que pouvaient déployer les nouvelles Églises. Face aux transformations du paysage religieux, les Kenyans ont fait preuve d’une certaine méfiance en craignant l’influence néfaste, les fraudes et l’hypocrisie des nouvelles dénominations. Elles ont ainsi pu être décrites comme des ruses du diable pour égarer les malheureux chrétiens, faisant passer les suppôts de Satan pour des Églises tout à fait légitimes. Au Kenya, les accusations de « déviances religieuses » – souvent proférées par des pasteurs d’Églises concurrentes pour prouver leur supériorité morale – fleurissent et sont le sujet d’intenses débats sur les valeurs morales de la société.
Une tolérance à géométrie variable
Cette inquiétude autour de la moralité de la société a engendré un rejet profond vis-à-vis des athées ou des partisans d’une certaine sécularité. En Afrique subsaharienne, les athées sont souvent considérés comme un groupe dangereux dont il faut se méfier, mais au Kenya cette défiance s’incarne tout particulièrement dans les déboires de la Société des athées du Kenya, l’une des rares du genre en Afrique.
L’association des Atheists in Kenya (AIK) s’est formée en 2012 sous la direction d’Harrison Mumia, un employé de la Banque Centrale du Kenya. Elle se propose de lutter contre l’enseignement religieux dans les écoles et s’adresse à un large public, en exigeant la création d’une fête nationale des athées et en promouvant la séparation de l’Église et de l’État. Plusieurs années et un recours devant la Cour suprême furent nécessaires pour que cette société – fort peu nombreuse, avec ses quelques centaines d’adhérent – soit finalement enregistrée au registre légal.
En outre, ses membres subissent de fortes pressions pour « retrouver » la foi, « voir la lumière » et avancer dans le « droit chemin », comme en témoigne la récente conversion au christianisme du secrétaire de la société.
Ainsi, la spiritualité au Kenya s’inspire de deux dynamiques paradoxales. D’une part, les pratiques religieuses dépassent largement les prescriptions institutionnelles des Églises et déploient une mobilité permettant aux Kenyans de connaître différents territoires spirituels. La société chrétienne du pays développe une forme d’œcuménisme en actes, freinant toute forme de tribalisme religieux et limitant les clivages politiques potentiels par le développement de réseaux sociaux multireligieux qui traversent les frontières des dénominations.
D’autre part, cette religiosité fluide et souple n’enlève rien au rejet que suscite le sécularisme et – surtout – l’athéisme. Si cet œcuménisme en actes présente une grande tolérance face aux différentes formes de christianisme et dans une moindre mesure face à l’islam ou aux « religions traditionnelles africaines », une profonde incompréhension règne face aux tenants d’une stricte laïcité, d’une forme d’agnosticisme, et, plus particulièrement, vis-à-vis de l’athéisme.![]()
![]()
Yvan Droz, Chercheur et maître de conférence en anthropologie et sociologie, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) et Yonatan N. Gez, Étudiant post-doctoral en anthropologie, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.